La catharsis en course à pied : mythe ou méthode efficace ?
« Tu es énervé ? Va te défouler, ça te fera du bien ! » Ce conseil populaire traverse les générations sans prendre une ride. Que l’on soit en colère, stressé ou contrarié, on se dit souvent que la solution est d’évacuer les tensions en se dépensant physiquement. Est-ce une vraie bonne idée ?
Certains se contentent de frapper les coussins du canapé (en hurlant à s’en péter les cordes vocales, tant pis pour les voisins !), d’autres enfilent les baskets et partent courir comme des dératés. Mais le sport, et plus particulièrement la course à pied, sont-ils des remèdes efficaces contre les problèmes que l’on rencontre dans la vie personnelle ou professionnelle ? Le running permet-il une catharsis ?
| Cata… Cathare… quoi ?
Le mot « catharsis » vient du grec katharsis qui signifie purification, nettoyage, séparation du bon et du mauvais. La catharsis désigne donc la purgation des émotions négatives, laquelle s’accompagne d’un changement positif dans la vie de l’individu. En psychanalyse, elle est un moyen thérapeutique grâce auquel le médecin amène le patient à se libérer de ses traumatismes affectifs refoulés. Il s’agit donc d’évacuer ce qui nous encombre : stress, tension, colère, énervement, peur… Plusieurs moyens permettent de procéder à une catharsis. Outre une thérapie psychiatrique, on peut aussi parler à un ami, écouter de la musique, écrire ce que l’on ressent, ou encore faire du sport. En quoi l’activité physique peut-elle aider à faire la paix avec soi-même et avec les autres ?

| L’action inhibe l’émotion
Les préparateurs mentaux le savent depuis longtemps : pour canaliser une émotion, par exemple avant une compétition, il vaut mieux être actif. Mettre en mouvement le corps permet de mieux gérer la tension mentale. L’esprit est occupé par l’action en cours plutôt que par l’angoisse de la course du lendemain. De même, lorsqu’on ressasse des préoccupations, aller courir contribue à trouver l’apaisement. Bien souvent, les pensées continuent à tourner pendant les premières minutes du footing mais, assez rapidement, elles s’atténuent, puis disparaissent complètement au profit d’une focalisation sur l’activité que l’on est en train de pratiquer. En ce sens, courir procure un certain bien-être car les ruminations cessent. L’effet est d’autant plus marqué si l’on est capable de courir en pleine conscience, c’est-à-dire de se concentrer sur l’instant présent et sur toutes les sensations éprouvées : l’air sur le visage, la chaleur sur les bras, l’odeur de la nature, la couleur des fleurs et du ciel… Pouvoir se connecter à « ici et maintenant » évacue les émotions négatives et les pensées récurrentes.
La course à pied, discipline d’endurance, procure aussi du bien-être parce qu’elle stimule la production d’endorphines, les fameuses hormones dont on devient vite dépendant tant elles engendrent un sentiment de plaisir. En s’offrant un shoot régulier d’endorphines, on a ainsi l’impression que courir nous aide à aller mieux. Pour peu que l’on coure assez longtemps ou assez intensément, l’exercice physique engendre de la fatigue qui favorise le sommeil, permet de mieux récupérer et donc de se sentir plus en forme de manière générale. Les soucis sont moins difficiles à affronter quand on est plus reposé.
Pour surmonter des obstacles de la vie, il n’est pas rare que certains se jettent à corps perdu dans la course à pied. S’entraîner devient une priorité car l’activité génère un bien-être qui nous manque : tant qu’on court, on oublie ses problèmes. Le temps de l’entraînement est comme une parenthèse dans la vie d’où viennent nos soucis, nos préoccupations, nos angoisses. Alors on court de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps, pour que ce moment hors du temps, hors du « vrai » monde prenne de plus en plus de place. Dans ce cas, réalise-t-on vraiment une catharsis ? Ou fuit-on simplement sans vraiment se purifier ?
| Et si ce n’était qu’un mythe ?
Beaucoup de coureurs affirment que la course à pied a été leur thérapie. Que courir leur a permis de traverser une période difficile de leur vie, de surmonter des problèmes graves, de se libérer. Parfois même de les sauver. Certains exemples médiatisés illustrent le rôle salvateur du running. Mais ne se voile-t-on pas la face ? Ne refuse-t-on pas de voir ce qui est réellement à l’œuvre dans la pratique – parfois outrancière – de la course à pied ? Si courir est une activité aux nombreux bienfaits pour la santé, elle peut aussi s’accompagner d’effets délétères : blessures, troubles du comportement alimentaire, surentraînement, coupure sociale et familiale, bigorexie…
Ceux qui vantent les vertus du running pour leur santé mentale ont cependant partiellement raison. Le sport ouvre à la fois un espace de défoulement physique et un temps rien qu’à soi, pendant lequel on se reconnecte à soi-même, à son corps, à ses sensations. Sans forcément purger le mental de ses préoccupations et ruminations, le running permet de s’accorder une pause dans le tourbillon des pensées et des émotions. Pour peu que l’on soit satisfait de la séance réalisée, il introduit aussi dans la boucle une récompense, une raison d’être fier de soi. Courir injecte du positif dans un circuit où tourne du négatif.
Mais le running permet-il pour autant une catharsis ? Pas si sûr. Des études ont montré qu’il était plus utile de pratiquer du yoga, de la méditation ou des exercices de respiration plutôt que du running, du vélo ou de la boxe lorsqu’on essaie de calmer une colère. Autrement dit, quand on se sent particulièrement énervé, les activités calmes sont préférables à celles qui font monter encore davantage le niveau d’excitation. Si l’on se sent agacé, aller courir deux heures n’est donc peut-être pas la meilleure idée ! De même, si l’on a tendance à s’auto-dévaloriser et à souffrir d’un cruel manque de confiance en soi, il n’est probablement pas très pertinent d’aller courir en groupe ou dans un lieu où l’on va se comparer aux autres : on trouvera une foule de raisons d’entretenir les ruminations et donc de ne pas aller mieux. Autre exemple : fuir une situation tendue dans le couple en allant courir le plus souvent possible risque fort d’entretenir les tensions, voire de creuser la distance entre les partenaires. Si le laps de temps passé dehors à gambader est une bouffée d’oxygène pour celui qui court, il est fort à parier qu’il étouffera la complicité, la communication et l’apaisement dans le foyer. Les exemples pourraient être multipliés et une kyrielle de cas réels pourraient être énumérée. Mal utilisée, la course à pied peut être tout-à-fait contre-productive.

En conclusion, il paraît difficile de trancher : mythe ou réalité de la catharsis dans le running ? La réponse ne peut être générique tant elle dépend de chaque cas, de chaque type de problème que l’on cherche à apaiser en pratiquant une activité sportive. Sans doute est-ce à chacun de tester ce que la course à pied peut lui apporter, tout en gardant à l’esprit que l’excès est souvent synonyme de fuite, d’étourdissement, voire de refus d’affronter la réalité. Indéniablement, courir pour oublier ses problèmes ne résout rien et s’apparente plutôt au shoot éphémère d’un drogué. En revanche, la course à pied peut tout-à-fait s’intégrer dans une démarche plus globale qui permet d’aller mieux. Elle est alors vraiment un « sport santé » dans toutes ses dimensions : physique, mentale, sociale. Elle peut aussi être une étape dans un processus de guérison, à condition d’être bien considérée comme telle et non comme une finalité.
| Pour aller plus loin
➜ Lire notre article : « Une foulée après l’autre : ensemble, les femmes (re)mettent leurs baskets »
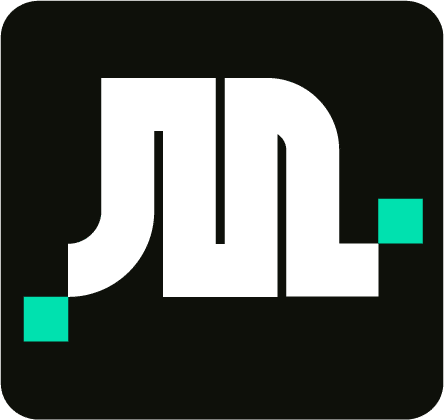
Marie Paturel
Journaliste



