Olivier Bessy : « On cherche à donner de l’intensité à sa vie et la course à pied offre cela »
Figure majeure de la sociologie du sport en France, Olivier Bessy consacre depuis plus de quarante ans ses travaux à la compréhension de la course à pied, de ses mutations et de son inscription dans nos modes de vie contemporains. Professeur émérite à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, chercheur au laboratoire TREE (Transition Environnementale et Energétique), il est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages de référence sur l’histoire et la sociologie de cette pratique devenue phénomène de société.
✓ Dans cet entretien, il revient sur cinquante ans de passion personnelle et scientifique pour décrypter l’évolution du coureur, des premiers joggeurs post-68 aux adeptes de l’ultra-trail et du strava jockey d’aujourd’hui.
| Quel est votre rapport à la course à pied ?
J’ai un rapport passionnel avec la course à pied, c’est en moi depuis 50 ans. J’ai traversé toutes les périodes de la course à pied en commençant en club sur la piste, puis avec du cross, des courses hors stade, jusqu’au trail et à l’ultra trail. Aujourd’hui, à 67 ans, je cours pour m’offrir un moment de méditation. Je mets les baskets dès que j’en ressens le besoin.
| Pourquoi vous-êtes vous intéressé à la thématique de la course à pied dans le cadre de votre travail ?
J’ai d’abord été professeur d’éducation physique et j’ai ensuite poursuivi mon cursus en tant qu’enseignant chercheur en UFR STAPS. J’ai écrit une thèse sur : « Le culte du corps et de la forme ». En 1981, j’ai voulu travailler sur la course à pied car j’étais déjà un grand adepte et je sentais que quelque chose se passait autour de cette discipline. En 1994, j’ai travaillé sur le Marathon du Médoc et j’ai écrit un livre pour les dix ans de cette manifestation. J’ai ensuite écrit une série de livres qui étudient la discipline car on ne peut pas comprendre ce qu’elle est aujourd’hui sans comprendre ce qui s’est passé avant.
« Aujourd’hui, les coureurs recherchent des modes de sociabilité plus souples et ouverts. De plus, avec les réseaux sociaux et les nouvelles technologies c’est possible de performer aujourd’hui sans être en club. »
Olivier Bessy
| Justement, dans votre ouvrage, « Courir de 1968 à nos jours, tome 1 : Courir sans entraves » paru aux éditions Cairn, vous parlez d’une première révolution après mai 68.
Oui tout démarre dans les années 70. Mai 68 c’est la libération des corps : jouir sans entraves, courir sans entraves. À ce moment, on s’émancipe de la fédération et les femmes se mettent à courir. Les années 70 c’est aussi la naissance de courses mythiques comme Marvejols-Mende (1973), Marseille-Cassis (1976), 20 km de Paris (1979). C’est comme cela que ce sport s’est développé.
| En 2024, la Fédération Française d’Athlétisme a recensé 2,95 millions de résultats sur route, trail et cross. Qu’est ce qui fait courir autant les gens aujourd’hui ?
Il n’y a pas qu’un facteur explicatif mais plusieurs qui convergent. Durant le Covid, courir a permis de se sentir exister, libre et vivant sur les laps de temps où l’on était autorisé à sortir. Aujourd’hui s’ajoute le culte de la performance qui irrigue toute la société. En plus de cela, on cherche aussi à donner de l’intensité à sa vie en vivant des expériences les plus mémorables possibles et la course à pied offre cela. Et puis, il ne faut pas oublier le besoin de se mettre en spectacle dans une société de l’image. Ces valeurs reflètent l’hypermodernité qui devient la forme sociétale dominante au tournant des années 1980 et 1990.

| Cette date marque la seconde révolution. En quoi cela a modifié la pratique de la course à pied ?
Les gens ont désormais un rapport au corps plus efficace, plus performatif et plus aventureux. L’hypermodernité a cassé tous les codes et a élargi les horizons.
| On évoque beaucoup les réseaux sociaux dans cette volonté de se mettre en spectacle. Leur existence est-elle une chose positive ou non pour la pratique ?
J’évite de porter un jugement de valeur, j’essaie simplement d’expliquer. Les réseaux sociaux sont dans nos vies, c’est donc tout naturellement qu’ils se sont invités dans la course à pied. La course à pied n’est pas qu’une pratique individuelle mais aussi sociale et les réseaux sociaux ont contribué à fédérer autour de ce sport via des applications. Désormais avec Strava, Garmin, et les autres, chaque runner peut montrer ce qu’il fait. Le symbole de cette hypermodernité c’est le « strava jockey ». C’est-à-dire que pour éblouir ta communauté tu payes quelqu’un pour réaliser un effort que tu n’es pas en mesure de faire. Il est important aujourd’hui de sortir de cette illusion hypermoderne et de travailler de nouveaux équilibres.
| Justement, après l’hypermodernité vous parlez aujourd’hui de transmodernité. Quelles valeurs se cachent derrière ce mot ?
Effectivement, depuis une dizaine d’années, les valeurs de l’hypermodernité sont travaillées par de nouveaux enjeux éthiques, environnementaux et sociaux. La transmodernité pose la question du sens que tu donnes à ta pratique, c’est une forme d’éco-humanisme. C’est l’objet de mon nouvel ouvrage « Courir sans limites : la révolution de l’ultra-trail 1990-2025« , qui va sortir fin juillet.
| On parle de 14 millions de pratiquants en France, soit 25% de la population. Pourtant le nombre de licenciés n’est en hausse que de 8% entre 2023 et 2024. Pourquoi ?
Depuis la première révolution de la course à pied dans les années 70 c’est la liberté qui prime en lien le mouvement spiridonien qui prône le plaisir dans l’effort et la conquête de son autonomie. Le club fait figure de contraintes et les gens avaient envie d’autre chose. Aujourd’hui, les coureurs recherchent des modes de sociabilité plus souples et ouverts. De plus, avec les réseaux sociaux et les nouvelles technologies c’est possible de performer aujourd’hui sans être en club.
| Si l’engouement pour la course à pied est grand, le prix des dossards pour les courses est de plus en plus élevé. Qu’aimeriez-vous dire aux organisateurs ?
J’aimerais leur dire qu’un bel événement ce n’est pas forcément un événement où il y a du monde. Privilégiez la stratégie qualitative. Ensuite, si vous souhaitez proposer un événement plus éco-responsable, il faut travailler la dimension environnementale mais aussi sociale et territoriale. L’idée est de penser la course en lien étroit avec les ressources du territoire pour que tout le monde puisse se l’approprier.
À travers le regard affûté d’Olivier Bessy, on comprend que la course à pied est bien plus qu’un simple sport : elle est un miroir de nos époques, de nos quêtes de liberté, de performance, de sens et de reconnexion. Des premières foulées libératrices de l’après-68 aux nouveaux enjeux éthiques et environnementaux portés par la transmodernité, courir reste un acte profondément humain, entre introspection et mise en scène. À chacun désormais de trouver son équilibre sur cette ligne de départ sans fin, où le plaisir, le partage et la responsabilité peuvent, eux aussi, mener la cadence.
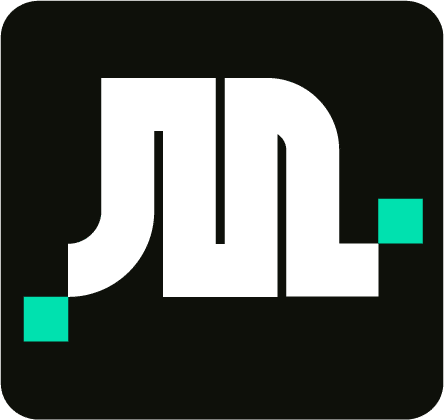
Julia Tourneur



